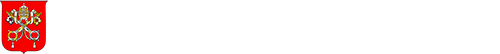Interview avec le Frère Guy Consolmagno, ancien directeur de la Specola Vaticana
En astronomie, on rencontre la beauté et la joie : des signes de la présence de Dieu. Savoir ce que signifient la beauté et la joie permet de les reconnaître aussi dans la prière, et donc de comprendre ce qu’il faut chercher dans la science. C’est ce qu’a affirmé le frère jésuite Guy Consolmagno, ancien directeur de la Specola Vaticana, de 2015 au 19 septembre 2025, dans cette interview accordée à www.vaticanstate.va
Comment le rôle de la Specola Vaticana a-t-il évolué au fil des ans en termes de contributions scientifiques ?
Les changements dans la manière dont la science est pratiquée à la Specola reflètent l’évolution de la science elle-même au cours des 130 dernières années. À l’origine, le travail de la Specola se limitait à quelques projets réalisés sous la direction du Directeur. La situation a commencé à changer avec la nomination du père Patrick Treanor en 1970 et, après sa disparition prématurée en 1978, a accéléré sous la direction de son successeur, le père George Coyne. Une nouvelle génération d’astronomes a rejoint le personnel, à qui l’on a donné l’indépendance nécessaire pour suivre leurs propres lignes de recherche.
Cependant, une grande partie du mandat de George Coyne a été consacrée à la construction du Vatican Advanced Technology Telescope (VATT), si bien que dans les années 1990 seuls deux ou trois astronomes étaient libres de produire des articles de recherche actifs. Heureusement, Coyne a également mené un programme de recrutement très réussi pour attirer de nouveaux astronomes jésuites à la Specola. Pendant ce temps, la recherche était principalement concentrée dans les bureaux de la Specola à Tucson.
Une fois que le télescope fut pleinement opérationnel et que bon nombre de ces nouveaux membres du personnel rejoignirent la Specola, le rythme de la recherche s’accrut réellement. Cela fut particulièrement évident pendant la période où le père José Funes était directeur. Le transfert vers un nouveau siège aux Villas pontificales, en 2009, permit de disposer de plus d’espace et de nouvelles installations scientifiques, comme un laboratoire pour étudier les météorites considérablement amélioré. Et José Funes développa l’institution des « astronomes auxiliaires », des scientifiques employés ailleurs mais affiliés à la Specola avec l’approbation du Vatican.
Ce contexte a donc posé les bases de la situation actuelle de la Specola. Nous disposons désormais d’une recherche scientifique active menée par une douzaine d’astronomes jésuites employés directement par la Specola dans de nombreux domaines différents, en particulier la spectroscopie stellaire, la météoritique et l’observation des planètes mineures, en plus du travail des « auxiliaires », souvent invités à se joindre à nous précisément parce que leurs domaines complètent ceux de la Specola. J’affirmerais qu’il serait difficile de trouver un domaine de recherche astronomique moderne où la Specola ne soit pas présente.
Ce travail s’est étendu jusqu’à inclure des recherches à l’avant-garde en histoire et en philosophie de l’astronomie, menées dans de nombreux cas par ces collaborateurs. Parmi eux, Ileana Chinnici et Christopher Graney ont tous deux publié des ouvrages multi-récompensés dans le domaine de l’histoire de l’astronomie, tandis que Louis Caruana et le père Giuseppe Tanzella-Nitti ont apporté d’importantes contributions en philosophie et en théologie de la science.
Le rôle de la Specola, tel qu’il nous a été confié par le Pape Léon XIII, est de montrer au monde que l’Église soutient la bonne science. Rien qu’en termes de nombre d’articles publiés, nous avons triplé la quantité de travaux soumis à une évaluation paritaire réalisés à la Specola au cours des trente dernières années. Nous avons également élargi notre portée auprès du public pour « montrer au monde »… comme cela sera expliqué plus avant.
Selon vous, quelles sont les découvertes les plus significatives faites par la Specola pendant votre mandat ?
Une façon de mesurer l’importance d’un article scientifique consiste simplement à voir à quelle fréquence il a été cité par d’autres articles. D’après ce critère, l’article le plus cité d’un membre de la Specola au cours des dix dernières années est l’étude sur le stripping du gaz des galaxies menée par Bianca Poggianti, qui incluait des contributions de l’astronome de la Specola Alessandro Omizzolo. Depuis sa publication en 2017, cet article a été cité 330 fois dans la littérature scientifique (selon la base de données NASA ADS).
Deux autres articles souvent cités comprennent des observations soutenant l’enquête Lamost sur les étoiles, avec des contributions de Chris Corbally, cité jusqu’à présent 123 fois, ainsi qu’un article de synthèse sur les propriétés physiques des météorites, dont Guy Consolmagno et Robert Macke sont coauteurs, cité 105 fois. L’article publié en 2018 dans la prestigieuse revue Nature par Richard D’Souza sur l’évolution de la galaxie d’Andromède est aussi particulièrement important ; il a été cité 112 fois et même présenté en couverture du Sky and Telescope Magazine.
Toutefois, lorsqu’on utilise uniquement le nombre de citations comme critère d’importance, le problème est que les articles plus anciens ont évidemment eu plus de temps pour être cités. Je souhaiterais donc mettre en avant deux recherches plus récentes qui, à mon avis, pourraient s’avérer très significatives à l’avenir.
La première est le travail sur la cosmologie de Gabriele Gionti et Matteo Galaverni.
Leurs calculs mathématiques sur différents types d’approches des questions cosmologiques ont été publiés dans une revue de physique prestigieuse et marquent un progrès significatif dans notre manière de chercher à comprendre la nature même de l’univers pendant les tout premiers instants après la création. En ce sens, il s’agit d’un petit pas, mais concernant une question très vaste et importante.
La seconde concerne la mesure des propriétés physiques des échantillons de l’astéroïde Bennu rapportés par la récente mission de la NASA et des météorites qui semblent être de bons analogues de ce matériau, un travail mené principalement par Robert Macke, de même que ses recherches sur la mission Lucy de la NASA consacrée aux astéroïdes troyens. Ses découvertes sur le comportement de ces échantillons aux températures propres aux astéroïdes seront essentielles non seulement pour notre compréhension scientifique de ces corps, mais aussi pour notre capacité à les exploiter ou à les dévier lorsqu’ils s’approchent de la Terre.
Comment voyez-vous la relation entre l’astronomie et la théologie, en particulier dans le contexte de la mission du Vatican ?
La science ne peut pas démontrer l’existence de Dieu et aucun principe théologique ne peut être dérivé de la science. De même, on ne trouve pas la réponse aux questions scientifiques dans les Écritures ou dans la Tradition. Il existe de nombreuses façons de le démontrer, mais la plus évidente est peut-être de rappeler que, même si la vérité est éternelle, la science que nous utilisons pour exprimer ces vérités limitées qui relèvent de son domaine est en perpétuelle évolution. En d’autres termes, une théologie fondée sur la meilleure science du moment deviendra obsolète dès que la science sur laquelle elle s’appuie sera remplacée par quelque chose de plus abouti.
Mais science et foi interagissent et se soutiennent mutuellement. Dans sa lettre au père Coyne, directeur de la Specola durant son pontificat, saint Jean-Paul II soulignait que « la science peut purifier la religion de l’erreur et de la superstition ; la religion peut purifier la science de l’idolâtrie et des faux absolus ».
Que puis-je ajouter à cela à la lumière de mon expérience avec la Specola Vaticana ?
Tout d’abord, je découvre que la science que je pratique me donne la conscience que toutes mes descriptions de la vérité, qu’elles soient scientifiques ou théologiques, ne sont rien d’autre que des métaphores poétiques de l’ineffable. Mais puisque c’est le cas, plus nous possédons d’images, plus nous pouvons utiliser de métaphores, mieux nous pouvons nous en approcher. Ainsi, la familiarité avec la science m’offre davantage de façons d’imaginer Dieu.
Elle me donne aussi une perception ou une familiarité avec la manière dont je sens “la vérité” lorsque je la rencontre. Je pense souvent à l’adage du mathématicien John von Neumann, qui disait : « On ne comprend jamais vraiment les mathématiques, on s’y habitue simplement ». Je crois que cela décrit bien la manière dont on peut s’habituer à Dieu et à la Nature… en passant beaucoup de temps avec chacun d’eux et en reconnaissant qu’il y a toujours quelque chose de plus à apprendre. C’est en effet une chose de dire (sincèrement) que Dieu est subtil, mais après tout, c’est Einstein qui en examinant un problème scientifique a forgé la phrase : « Dieu est subtil, mais il n’est pas malicieux ».
Enfin, en astronomie, je rencontre la beauté et la joie. Pour moi, ce sont des signes de la présence de Dieu. Savoir ce que signifient la beauté et la joie me permet de m’y habituer et de les reconnaître également dans ma prière. Et, réciproquement, les connaître dans la prière me permet de comprendre ce qu’il faut chercher dans ma science !
Quelles sont les plus grandes difficultés auxquelles les astronomes modernes doivent faire face aujourd’hui et comment la Specola Vaticana y répond-elle ?
Au cours des 70 dernières années, l’astronomie a fait d’énormes progrès grâce à un important soutien gouvernemental à la recherche scientifique, tout d’abord aux États-Unis, puis dans toute l’Europe occidentale, au Japon et maintenant aussi en Chine. Ce soutien a été bipartisan et constant, malgré les nombreux changements des tendances politiques et sociales. Mais cette situation est aujourd’hui menacée, plus directement aux États-Unis mais également dans d’autres régions du monde.
Le problème ne concerne pas seulement l’argent, mais reflète un changement plus large des positions de la société. Alors qu’autrefois on pouvait débattre pour savoir quelle religion était vraie, aujourd’hui c’est le concept même de vérité qui est attaqué. Pourquoi cela se produit-il ? Je crois que, au moins en partie, beaucoup de personnes ont peur de se confronter à des vérités dérangeantes qui mettent à l’épreuve leurs privilèges, leur bien-être personnel et leur sentiment de sécurité. Ironiquement, la science comme la religion sont toutes deux touchées par cette attaque culturelle, car toutes deux affirment l’existence d’une vérité objective.
Le résultat de ces attaques n’affectera pas seulement la quantité d’argent disponible pour la recherche fondamentale, mais aussi la considération sociale dont font l’objet ceux qui travaillent dans la science. En termes simples, tout comme la taille réduite des familles a amené des parents à être moins disposés à laisser leurs enfants devenir religieux et célibataires, de la même manière les préjugés sociaux contre la science amèneront les parents à être moins enclins à se réjouir que leurs enfants suivent des carrières qui n’offrent pas les avantages évidents que la société considère désormais comme prioritaires, comme le fait de gagner beaucoup d’argent.
L’existence de la Specola Vaticana s’oppose fortement à cette tendance culturelle.
Tout d’abord, elle insiste sur le fait que la connaissance pure de la création de Dieu est en soi utile. Ensuite, elle souligne que posséder une telle connaissance, même imparfaitement, est possible et constitue un objectif valable dans la vie. Et enfin, bien sûr, le Vatican fournit à travers la Specola les ressources stables pour découvrir et diffuser concrètement cette vérité. En défendant la science et la vérité, la Specola Vaticana affirme une position forte dans un climat où de telles affirmations sont à la fois nécessaires et courageuses.
Comment concilier la compréhension scientifique du cosmos avec les enseignements théologiques de l’Église ?
La réponse simple est de dire que l’Église enseigne que Dieu a créé l’univers ; la science me dit comment cela a été fait. Plus profondément, il est important de reconnaître que l’Écriture est un livre sur Dieu, non sur la science. Dans l’Écriture, il existe de nombreuses descriptions différentes de l’univers créé, certaines plus détaillées que d’autres. Elles représentaient toutes la « meilleure science de leur temps » — c’est-à-dire qu’aujourd’hui, elles ne sont pas concordantes entre elles lorsqu’il s’agit de décrire les événements de la création, car la science utilisée pour décrire ces événements a radicalement changé au cours des mille années pendant lesquels l’Écriture a été rédigée. Mais ce qui reste constant, c’est le rôle de Dieu dans cette création.
Dieu est un. Dieu est en dehors de la création, en dehors de l’espace et du temps, et Il est l’auteur de l’espace, du temps et des lois de la création. Dieu crée délibérément, non par hasard mais par choix. Dieu trouve la création bonne, et la création loue son Créateur. Et Dieu crée dans la lumière : nous, ses créatures, sommes encouragés à voir et à nous réjouir de ce qu’Il a créé et de la manière dont Il l’a fait. En effet, le point culminant de l’histoire de la création dans Genèse 1 est le sabbat, le jour où nous est donné le temps et l’espace pour nous détendre et apprécier cette création.
Qu’est-ce qui vous a initialement poussé à vous consacrer à la fois à l’astronomie et à la vie religieuse et comment cette combinaison unique a-t-elle façonné votre carrière ?
Lorsque j’étais enfant, dans les écoles catholiques américaines des années 1950 et 1960, les religieuses et les prêtres qui m’enseignaient les sciences m’encouragèrent à les étudier. Je n’ai jamais rencontré l’idée que la foi et la science devaient s’opposer. J’ai également rencontré d’excellents modèles religieux pendant mes études universitaires. Le MIT avait un aumônier renommé, le prêtre pauliste Robert Moran, arrivé en 1974. Puis, lorsque j’ai commencé mon programme de doctorat en Arizona en 1975, j’ai rencontré à la fois un scientifique qui était un ancien prêtre salésien, Godfrey Sill, et un autre scientifique qui était jésuite, George Coyne. J’avais donc de nombreux exemples pour me montrer qu’il est possible d’être à la fois religieux et scientifique.
Dans mon enfance, je n’avais jamais vraiment eu de crise de foi particulière à propos de ma religion, mais vers la fin de la vingtaine, j’ai commencé à remettre en question la valeur de mon travail en astronomie. Par conséquent, j’ai passé deux ans comme volontaire en Afrique avec le Peace Corps des États-Unis ; là-bas, j’ai constaté que les personnes que j’ai rencontrées au Kenya accordaient de la valeur à mon travail en astronomie. Et grâce à elles, j’ai également découvert mon amour pour l’enseignement et, finalement, j’ai ressenti l’appel à enseigner l’astronomie en tant que jésuite.
Cependant, je ne voyais pas vraiment de lien entre la vie religieuse et la carrière scientifique elle-même, tout comme je n’aurais pas vu de lien entre être scientifique et être marié. Ce n’est qu’après être entré dans la Compagnie de Jésus, pendant ma formation, que j’ai été encouragé à réfléchir profondément au lien entre aimer la création et aimer son Créateur. En particulier, je me souviens d’un cours pendant mes études de philosophie où j’eus l’occasion de lire De l’Incarnation du Verbe d’Athanase ; puis le lien devint soudainement évident.
En regardant en arrière, quel est selon vous votre apport le plus significatif à la fois pour la communauté scientifique et pour le Vatican ?
Lorsque je suis arrivé à la Specola Vaticana en 1993, j’ai découvert sa collection importante de météorites, qui à l’époque n’était pas bien entretenue. La météoritique était une de mes passions depuis mes premières études au MIT et, dans mon travail théorique sur l’évolution des petites lunes, j’avais reconnu la nécessité de disposer de mesures précises des propriétés physiques des météorites. Naturellement, un tel programme de mesures demandait beaucoup de temps pour être réalisé ; il ne pouvait pas être facilement mené si l’on était un professeur en quête d’un poste permanent ou un chercheur avec une subvention gouvernementale ayant un objectif spécifique et des contrats de trois ans. Mais à la Specola Vaticana, je n’avais aucune de ces contraintes.
J’ai pu consacrer près de vingt ans au développement de systèmes sûrs et fiables pour effectuer les mesures que je jugeais utiles. Ce travail n’était pas du tout fascinant, mais il a été considéré comme fondamental pour une grande partie de l’exploration de la ceinture d’astéroïdes, source de ces météorites. Et, contrairement à mon travail théorique précédent, il continue d’être utile bien après que les modèles théoriques qui l’avaient inspiré ont été remplacés par des travaux plus aboutis.
Travailler dans le domaine de la météoritique a également permis que la collection vaticane soit de nouveau mise à la disposition de la communauté scientifique au sens large. Je peux citer de nombreux collègues scientifiques qui ont publié d’autres articles importants en se basant à la fois sur nos données et sur nos météorites.
Mais il se passe ici aussi quelque chose de plus profond. En effectuant délibérément ces mesures, certes banales, j’ai réussi à me rappeler à moi-même et à certains de mes collègues pourquoi nous faisons réellement ce travail. Je ne cherche plus le prestige ni les éloges de mes pairs ; je suis plutôt heureux d’être un collaborateur précieux dans le cadre du travail plus large visant à comprendre notre système solaire. Je dis, à juste titre, que j’étudie la création par amour de son Créateur. Mais je le fais aussi pour la joie de faire partie d’une communauté plus large de chercheurs dans le domaine des météorites, des personnes avec qui j’aime être et partager ce que nous avons appris.
Ce type d’exemple — être scientifique pour la connaissance plutôt que pour une carrière de promotion personnelle — a des répercussions sur les personnes avec lesquelles nous travaillons. Et cela présente également le Vatican sous un jour favorable sur la scène mondiale. J’ai eu le privilège de représenter le Saint-Siège à une conférence des Nations Unies sur les usages pacifiques de l’espace extra-atmosphérique en 2018. J’ai également exercé des fonctions au sein de nombreuses organisations scientifiques internationales, notamment l’Union astronomique internationale, l’American Astronomical Society et la Meteoritical Society. Notre travail met en avant la bonne réputation du Vatican dans de nombreux lieux différents, où autrement il pourrait ne pas être reconnu.
Maintenant que vous êtes à la retraite, que ferez‑vous dans un avenir proche ?
Je me suis retiré de mes fonctions de directeur de la Specola, mais je ne prendrai pas ma retraite de la Specola elle-même. Je continuerai à faire de la science dans le domaine de la météoritique et à poursuivre mon travail en donnant des conférences et en écrivant pour le grand public. J’ai plusieurs idées de livres que je pourrais écrire à l’avenir ! De plus, j’aurai également un rôle important à jouer pour l’avenir de la Specola en tant que président de la Vatican Observatory Foundation, qui a été fondée aux États-Unis il y a environ quarante ans pour soutenir le travail de la Specola Vaticana.
C’est en particulier la Fondation qui a construit le Vatican Advanced Technology Telescope en Arizona, au début des années 1990. Aujourd’hui, la Fondation collecte les fonds nécessaires au fonctionnement du télescope. De plus, la Fondation apporte un soutien financier à de nombreuses initiatives éducatives et de sensibilisation du public de l’Observatoire du Vatican, notamment les écoles d’été organisées et animées par l’Observatoire à son siège de Castel Gandolfo, ainsi que des programmes spéciaux pour scientifiques et éducateurs organisés par l’Observatoire du Vatican aux États-Unis.
Ainsi, une grande partie de mon activité de sensibilisation comprendra à l’avenir des initiatives de collecte de fonds… à la fois pour obtenir des capitaux auprès des principaux donateurs et pour offrir aux donateurs plus modestes un moyen de participer à la mission confiée par le Pape Léon XIII il y a de nombreuses années : montrer au monde comment l’Église soutient la bonne science.